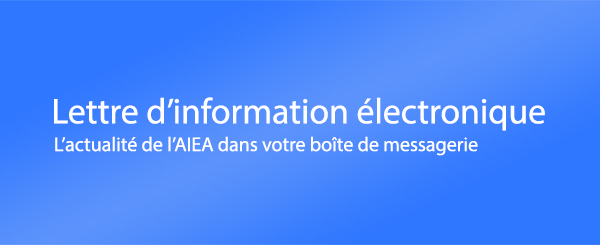Assis dans une usine de traitement du combustible nucléaire du Sud de la France, le physicien Francis Perrin se dit à lui-même : « C’est impossible ». Cela se passait en 1972. D’un côté, un morceau de minerai d’uranium radioactif naturel de couleur sombre, extrait d’une mine en Afrique, de l’autre, des données scientifiques validées indiquant que la teneur des minerais en uranium radioactif est constante.
L’analyse de ce minerai à haute teneur provenant d’une mine du Gabon a montré qu’il contenait une plus faible proportion d’uranium 235 ( 235U), le seul de type fissile. Cette différence, bien qu’infime, était suffisante pour rendre les chercheurs perplexes.
La première explication logique avancée par les physiciens pour justifier une teneur aussi inhabituelle en uranium 235 était qu’il ne s’agissait pas d’uranium naturel. De nos jours, celui-ci contient toujours 0,720 % d’uranium 235, qu’il provienne de la croûte terrestre, de roches lunaires ou de météorites. Mais ce morceau de roche d’Oklo ne contenait que 0,717 % d’uranium 235.
Comment expliquer cela ? La seule explication initialement trouvée par les physiciens était que le minerai d’uranium avait subi une fission artificielle, c’est-à-dire qu’on avait provoqué une scission forcée de certains atomes d’uranium 235 par une réaction nucléaire en chaîne. Cela pouvait expliquer la teneur anormalement faible en uranium.
Cependant, des analyses complémentaires ont permis à Francis Perrin et à ses collègues d’attester que le minerai d’uranium était totalement naturel. Fait encore plus curieux, ils ont découvert des traces de produits de fission dans ce minerai. Ils en ont conclu que le minerai d’uranium était naturel et avait subi une fission. La seule explication possible était que cette roche témoignait d’une fission naturelle qui avait eu lieu il y a plus de deux milliards d’années.
« À l’issue d’études supplémentaires et notamment d’analyses effectuées sur place, les chercheurs ont découvert que la fission du minerai d’uranium avait été auto-entretenue », raconte Ludovic Ferrière, conservateur de la collection de roches au Muséum d’histoire naturelle de Vienne, où un morceau de cette roche singulière sera présenté au public en 2019. « Il n’y avait aucune autre explication possible », poursuit-il.
Pour qu’un tel phénomène ait pu se produire naturellement, il a fallu que ces gisements d’uranium d’Afrique équatoriale occidentale contiennent une masse critique d’uranium 235 pour que la réaction soit amorcée. C’était effectivement le cas à l’époque.
Un autre facteur ayant favorisé ce phénomène est que le déclenchement et le maintien de toute réaction nucléaire en chaîne nécessite un modérateur. Dans ce cas, c’était l’eau. Si celle-ci n’avait pas ralenti les neutrons, la fission contrôlée n’aurait pas été possible. Les noyaux atomiques ne se seraient tout simplement pas scindés.
« Tout comme les réacteurs nucléaires à eau légère artificiels, les réactions de fission s’arrêtent inévitablement en l’absence d’un élément qui ralentit, ou modère, les neutrons », explique Peter Woods, chef d’équipe chargé de la production d’uranium à l’AIEA. « L’eau a joué le rôle de modérateur à Oklo, en absorbant les neutrons et en contrôlant la réaction en chaîne ».
Le contexte géologique spécifique de ce qui est aujourd’hui le Gabon a également aidé. Les concentrations chimiques totales en uranium (notamment en 235U) étaient suffisamment élevées et les divers gisements individuels d’une épaisseur et d’une grandeur suffisantes. Dernier facteur favorable : la région d’Oklo a réussi à résister à l’épreuve du temps. Les experts pensent qu’il y a peut-être eu d’autres réacteurs naturels similaires dans le monde, mais qu’ils ont probablement été détruits par des processus géologiques, dégradés par l’érosion, en subduction ou n’ont tout simplement pas encore été découverts.
« Le plus fascinant dans cette histoire, c’est la manière dont le temps, la géologie et l’eau se sont alliés pour permettre à ce phénomène de se produire et d’être préservé jusqu’à nos jours », commente Peter Woods, qui précise que l’énigme est résolue.
Un échantillon de la roche est dans la ville qui abrite le siège de l’AIEA
Nous voulons que les gens en sachent plus sur la radioactivité naturelle et qu’ils prennent conscience du fait que la radioactivité est un phénomène omniprésent dans la nature qui ne présente aucun danger à de faibles niveaux.