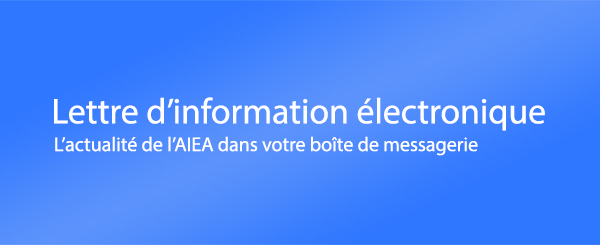Depuis plus d’un demi-siècle, les garanties de l’AIEA sont un moyen efficace de vérifier que les matières et activités nucléaires sont utilisées à des fins pacifiques. Nous célébrons cette année deux anniversaires importants pour les garanties : le 50e anniversaire de l’entrée en vigueur du premier accord de garanties généralisées (AGG) dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) et le 25e anniversaire de l’entrée en vigueur du premier protocole additionnel (PA). Ces anniversaires importants sont l’occasion de réfléchir à l’évolution du système des garanties et d’envisager son avenir.
Le premier système des garanties portait sur des éléments particuliers, ce qui signifie que les garanties ne s’appliquaient qu’aux matières, équipements et installations nucléaires qu’un État choisissait de soumettre aux garanties. Une évolution vers un système de garanties généralisées s’est produite en 1967, lorsque des pays d’Amérique latine et des Caraïbes ont conclu un accord qui a donné lieu au tout premier traité interdisant les armes nucléaires dans une région peuplée du monde. Ce traité, le Traité de Tlatelolco, a ouvert un nouveau chapitre en obligeant les parties à accepter les garanties de l’AIEA sur toutes les matières et activités nucléaires. Le Mexique a été le premier État à conclure un accord en vertu du Traité de Tlatelolco.
Un an plus tard, en 1968, le TNP a été ouvert à la signature. L’article III du TNP exige que chaque État non doté d’armes nucléaires conclue avec l’AIEA un accord de garanties s’appliquant à « toutes matières brutes ou tous produits fissiles spéciaux dans toutes activités nucléaires pacifiques ». Pour répondre à cette exigence, des AGG ont été établis. La Finlande a été le premier État à faire entrer en vigueur un AGG dans le cadre du TNP, en 1972.
Au début des années 1990, la découverte de matières et d’activités nucléaires non déclarées en Iraq a démontré la nécessité de renforcer le système de garanties de l’AIEA. En 1993, l’AIEA a lancé le Programme 93+2 afin de renforcer l’application des garanties dans le cadre des AGG et d’améliorer la capacité de l’AIEA à vérifier non seulement l’exactitude mais aussi l’exhaustivité de la déclaration d’un État concernant les matières nucléaires soumises aux garanties. Ce programme a conduit à l’adoption du PA en 1997. Un PA donne à l’AIEA des droits d’accès à l’information et aux emplacements élargis. L’Australie a été le premier État à faire entrer en vigueur un PA.
Au début des années 2000, l’AIEA a commencé à élaborer et à mettre en œuvre des méthodes de contrôle au niveau de l’État (MNE) pour les États ayant conclu un AGG, s’éloignant ainsi progressivement des méthodes génériques de contrôle d’installations. Dans le cadre des efforts visant à permettre à l’Agence de tirer pleinement parti de la souplesse offerte par les MNE (dans le cadre de l’accord de garanties pertinent), l’AIEA a commencé en 2011 à mettre à jour et à adapter les MNE existants sur la base de facteurs propres aux États concernés. En 2019, un projet a été lancé pour améliorer encore les MNE par la définition d’objectifs de performance.
À l’avenir, la demande concernant les garanties de l’AIEA devrait continuer à augmenter, et les nouvelles technologies apporteront à la fois de nouvelles perspectives et de nouvelles difficultés. Nous devons déployer des infrastructures et du matériel de contrôle modernisés, et poursuivre l’élaboration et l’harmonisation des méthodes, des outils et des méthodologies de contrôle. Avec le soutien de nos États Membres, je suis convaincu que nous saurons relever les défis auxquels nous faisons face et faire en sorte que les garanties de l’AIEA demeurent une composante clé des efforts mondiaux de non-prolifération dans les décennies à venir.