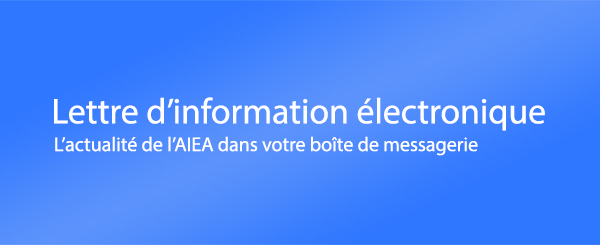
Si vous souhaitez en savoir plus sur les activités de l’AIEA, abonnez-vous à notre lettre électronique mensuelle pour recevoir les principales informations, multimédias et autres.
La sûreté dès la conception
La nouvelle génération de réacteurs nucléaires face aux enjeux liés à la sûreté
Joanne Liou
C’est sous les tribunes du stade d’athlétisme de l’Université de Chicago qu’a eu lieu la première réaction nucléaire en chaîne auto-entretenue, en 1942. Dans un cadre en bois, des blocs de graphite empilés en alternance avec de l’uranium formaient la « pile » – le réacteur nucléaire. Au-dessus de cette structure, une barre de commande était suspendue à une corde ; un homme vêtu d’une tenue de protection se tenait à côté, prêt à couper la corde avec une hache si les choses devaient mal tourner. La barre tomberait alors dans le cœur du réacteur, ce qui provoquerait l’arrêt de la réaction en chaîne. Cet homme incarnait le premier système de sûreté nucléaire.
Dans les décennies qui ont suivi, la sûreté a influencé l’évolution des réacteurs, depuis les prototypes mis au point dans les années 1950 et les réacteurs de puissance commercialisés dans les années 1960 jusqu’aux modèles avancés qui sont apparus dans les années 1990. Bien loin de l’homme à la hache de l’époque, les réacteurs d’aujourd’hui sont le fruit d’une conception et de systèmes qui garantissent un haut niveau de sûreté.
Les modèles de réacteurs qui font une large place à l’innovation sont certes prometteurs, mais supposent une procédure rigoureuse d’évaluation de la sûreté et d’autorisation, qui soit appliquée par un organisme de réglementation afin de valider leur utilisation et leur déploiement.
Parmi les réacteurs nucléaires de nouvelle génération, certains sont déjà en service, tandis que d’autres n’ont pas encore été déployés. L’AIEA distingue les réacteurs nucléaires avancés selon qu’ils sont évolutifs ou innovants, chacun de ces deux types intégrant les enseignements tirés de l’accident nucléaire de Fukushima Daiichi survenu en 2011. Les réacteurs évolutifs améliorent les conceptions existantes tout en conservant des caractéristiques éprouvées, tandis que les réacteurs innovants font appel à des technologies nouvelles.
La plupart des réacteurs évolutifs sont disponibles sur le marché et sont déjà connectés au réseau. Ces réacteurs reposent sur une approche de la sûreté qui est fondée sur l’application d’une stratégie de défense en profondeur, améliorée par rapport aux réacteurs traditionnels : cette stratégie mise davantage sur les caractéristiques de sûreté intrinsèques et les dispositifs de sûreté passive, et moins sur l’intervention de l’exploitant pour limiter au maximum le risque d’accident.
Les réacteurs innovants intègrent des changements radicaux pour ce qui est de l’utilisation des caloporteurs, des combustibles, des environnements d’exploitation et des configurations systèmes. La mise en service de certains d’entre eux devrait intervenir dans les dix ou vingt prochaines années.
« D’un point de vue technologique, [les réacteurs innovants] sont très différents dans la mesure où, en général, ils n’utilisent pas l’eau comme caloporteur », explique Stefano Monti, chef de la Section du développement de la technologie électronucléaire de l’AIEA. Il précise que, du point physique, le recours à un caloporteur autre que l’eau modifie également la façon dont la chaleur est extraite et dont la réaction de fission nucléaire est produite et entretenue.
Les réacteurs à neutrons rapides avancés qui sont refroidis au sodium, au plomb et au plomb-bismuth ou au gaz, par exemple, utilisent des neutrons d’un niveau d’énergie bien plus élevé pour provoquer la fission. Les réacteurs de ce type sont conçus pour permettre une consommation plus efficiente du combustible et réduire ainsi la quantité de déchets hautement radioactifs. « Sur le plan de la sûreté, les risques associés à leur exploitation sont très faibles, puisque tant la probabilité que les conséquences radiologiques possibles d’un accident sont ténues », affirme Vesselina Ranguelova, chef de la Section de l’évaluation de la sûreté de l’AIEA. Le Système d’information sur les réacteurs avancés de l’AIEA fournit des informations détaillées concernant les aspects techniques et la sûreté de tous ces types de réacteurs.
Les premiers petits réacteurs modulaires (PRM) avancés à être déployés dans le monde ont été mis en service l’an dernier en Russie, et de nombreux PRM innovants sont en cours d’élaboration en vue d’un déploiement à court terme. À l’échelle mondiale, on compte quelque 70 concepts et modèles de PRM, dont deux à un stade de construction avancé, en Argentine et en Chine.
Systèmes de sûreté
Les enseignements tirés à la suite de l’accident de Fukushima ont conduit à un renforcement important des prescriptions internationales en matière de sûreté, lesquelles doivent être prises en compte dès la conception des réacteurs avancés de sorte que la probabilité que survienne un accident ayant des conséquences radiologiques graves serait extrêmement faible et que, si tel devait être le cas, ces conséquences seraient pratiquement éliminées.
La démonstration du bien-fondé de la conception des PRM implique pour les vendeurs de prouver l’efficacité des fonctions de sûreté principales – commande du réacteur, refroidissement du cœur et confinement de la radioactivité – à la lumière de l’élaboration et de l’évaluation des stratégies de défense en profondeur.
À titre d’exemple, l’entreprise NuScale Power établie aux États-Unis a conçu un réacteur modulaire à eau ordinaire, qui intègre les composants pour la génération de vapeur et l’échange de chaleur dans une seule unité. Sa mise en service est prévue pour 2027. « Le principal défi auquel doit faire face le parc nucléaire actuel en matière de sûreté concerne la capacité des installations à évacuer la chaleur résiduelle (décroissance) et à refroidir le réacteur », explique Carrie Fosaaen, directrice chargée des affaires réglementaires chez NuScale Power. « La conception générale de la centrale nucléaire NuScale fait appel à des systèmes plus simples, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’avoir recours aux configurations complexes que requièrent les installations nucléaires actuelles. »
Compte tenu de la nature de l’innovation, l’introduction de dispositifs de sûreté passive et d’autres nouveautés en matière de sûreté présente un défi d’ordre réglementaire. Il incombe en effet aux organismes de réglementation de vérifier les affirmations des concepteurs concernant la sûreté, ce qui peut nécessiter des recherches et des analyses supplémentaires lorsqu’il s’agit d’évaluer des modèles novateurs.
« Pour démontrer la sûreté de la conception, une évaluation exhaustive couvrant tous les états de la centrale – fonctionnement normal, incidents de fonctionnement prévus et conditions accidentelles – doit être réalisée. À partir de là, on peut déterminer la capacité de résistance du modèle à des événements internes et externes et démontrer l’efficacité des dispositifs de sûreté », explique Vesselina Ranguelova. « Les modèles de réacteurs qui font une large place à l’innovation sont certes prometteurs, mais supposent une procédure rigoureuse d’évaluation de la sûreté et d’autorisation, qui soit appliquée par un organisme de réglementation afin de valider leur utilisation et leur déploiement. »
Un cadre technologiquement neutre en matière de sûreté
L’AIEA s’emploie à évaluer dans quelle mesure ses normes de sûreté peuvent être appliquées aux technologies innovantes. « Nos normes de sûreté sont neutres sur le plan technologique. Toutefois, elles ont été en grande partie élaborées sur la base de l’expérience d’exploitation de réacteurs qui sont essentiellement refroidis par eau », précise Vesselina Ranguelova. Bien que les normes reposent sur un principe de neutralité, leur application peut différer pour certains, voire tous les types de PRM.
« Des lacunes existent dans certains domaines, pour lesquels nous allons devoir définir des orientations supplémentaires ou des documents complémentaires pour permettre l’application de ces normes aux technologies innovantes », indique Vesselina Ranguelova. L’AIEA devrait publier, en 2022, un rapport de sûreté sur l’applicabilité de ses normes de sûreté aux technologies des PRM.




