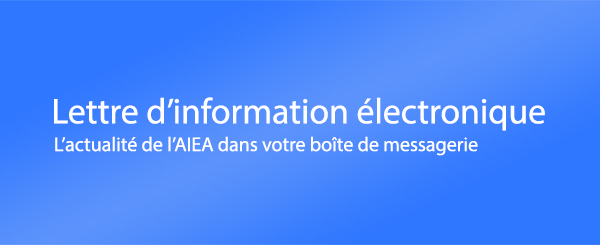Au-delà de l’étude des polluants marins, M. Uddin explique que les techniques nucléaires sont particulièrement utiles pour nous aider à mieux cerner les effets directs du changement climatique sur la croissance des organismes marins. Dans le cadre d’une autre étude sur les copépodes, M. Uddin a constaté que si l’on augmentait l’acidité et la température de l’eau durant un an, les copépodes étaient capables de s’adapter à ces nouvelles conditions sur 14 générations.
Dans une troisième étude, M. Uddin a élevé des crevettes dans des eaux de plus en plus acides, sur la base des modélisations des scénarios avancés de changement climatique. Un radiotraceur, le calcium 45, a permis de comprendre l’effet de l’acidification des océans sur la transparence des exosquelettes des crevettes (un indicateur de leur santé). Il est apparu que les crevettes ne changeaient pas de taille d’une génération à l’autre mais étaient moins performantes et devaient consommer deux fois plus de nourriture pour atteindre leur poids normal.
« À en juger par les résultats, même si les effets du changement climatique venaient à perdurer, tout espoir ne serait pas perdu pour la vie marine. Dans nos études, nous constatons que les copépodes et les crevettes s’adaptent au changement climatique au fil des générations », indique M. Uddin.